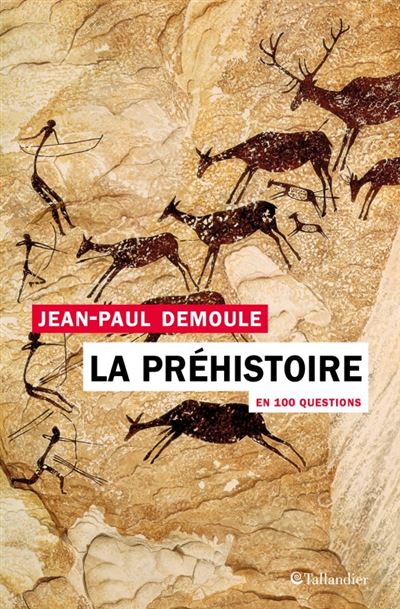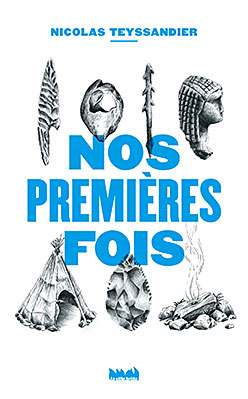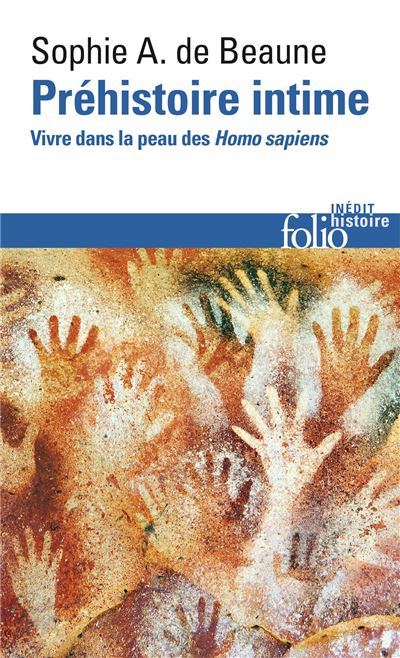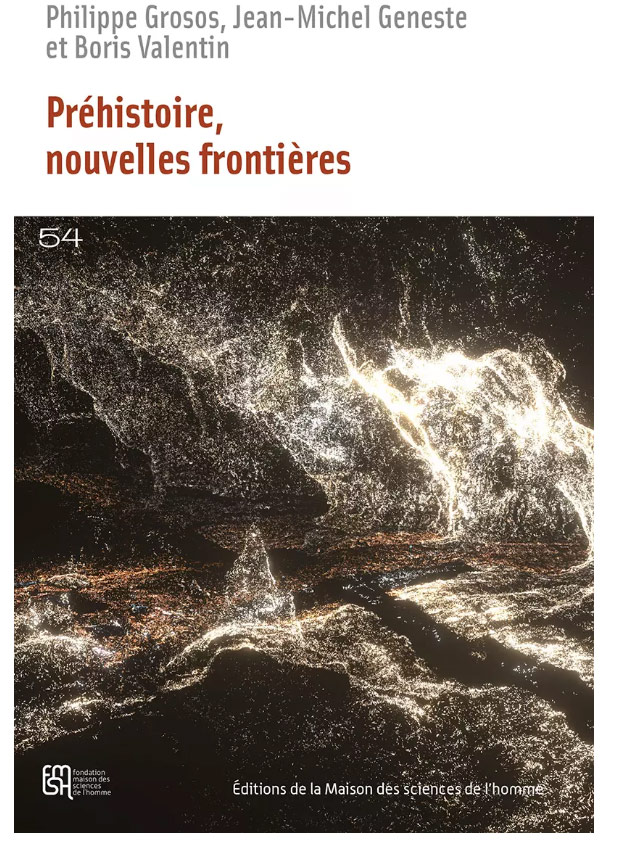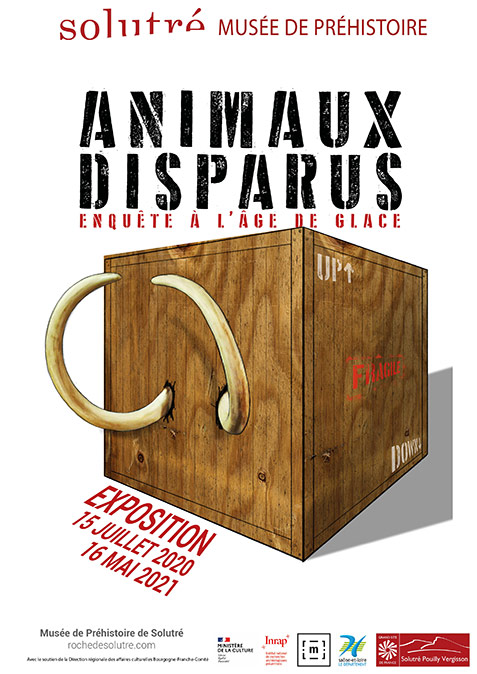De l’homme et de l’animal… Les outils et conclusions – 3ème partie
De l’homme et de l’animal : différences de degré, de nature ou d’orientation ?
Fabrice Garcia, Docteur en philosophie.
Résumé
Si la frontière entre l’homme et les autres espèces semble de plus en plus incertaine aujourd’hui, en raison de nombreuses découvertes éthologiques et même primatologiques, force est d’entreprendre la relecture des faits proposés par ses disciplines, afin d’éclaircir la différence qui existe pourtant entre l’être humain et les animaux – et ce, grâce à une nouvelle hypothèse : l’espèce humaine en effet est la seule à élaborer des conceptions et des visions du monde. Sa différence avec les autres vivants (et leur rapport à la vie) est d’orientation et non de degré. Il s’agit alors de découvrir les signes qui prouvent l’existence de telles facultés en l’homme, et d’expliquer cette hypothèse de la différence d’orientation.
De l’homme et de l’animal : différences de degré, de nature ou d’orientation
I – Mensonge – Tromperie tactique
II – Le rire – La Famille
III – Les outils – Conclusion
III – LES OUTILS
A nouveau, l’éthologie a prétendu remettre en cause la séparation de l’homme et de l’animal après avoir découvert des

outils chez certaines espèces. Ainsi, les pinsons des îles Galapagos sont capables de récupérer des épines de cactus pour tuer des fourmis dans les interstices des arbres fêlés ; de même encore, les loutres utilisent des pierres pour casser les oursins ; et plus récemment, des corbeaux capables de construire en laboratoire un outil en vue d’un usage ultérieur ont été filmés. Si de tels faits sont stupéfiants, il faut quand même rappeler que, dès 1930, le livre de M. Vignon, introduction à la biologie expérimentale des êtres organisés ; activités, instincts, structures fait mention des outils chez certaines espèces (ainsi son fameux exemple des éléphants qui cassent des piquets de bambous pour s’en faire des grattoirs afin de déloger les sangsues fixées à leur peau), suggérant que l’homme n’est plus exceptionnel de par son activité technique – et les intellectuels de l’époque ayant entièrement conscience de la nouvelle image de l’animal que dressait l’éthologie naissante (ainsi de Pierre Janet, alors au Collège de France, commentant le livre de M. Vignon dans les débuts de l’intelligence). Les querelles à ce sujet, pour distinguer l’homme des autres espèces, sont toujours les mêmes : quelle est la définition de l’outil ? Or, nous aimerions montrer qu’il est impossible de poser la question sous cette forme, dans la mesure où se sont les cultures qui élaborent un principe de réalité à partir duquel inventer le sens, la valeur et les objectifs de telles notions – à partir à nouveau des conceptions. Faute de place ici, donnons-en un aperçu rapide pour légitimer une telle hypothèse.
Repartons ainsi du philosophe qui a fondé le terme « sociologie » : Auguste Comte. Prenons la technique à la lumière de « la loi des trois états » qu’il développe (1) . Certes, il n’y a plus personne aujourd’hui pour croire en la naïveté de l’hypothèse du philosophe, qui pense que l’humanité progresse dans la conscience d’elle-même au travers trois stades qui se suivent logiquement et que toute culture est censée traverser : théologique, métaphysique et scientifique. Il y a certes une naïveté à croire qu’il y a nécessairement un progrès ; une autre naïveté à croire qu’il existe la théologie ou la religion (alors qu’il n’existe peut-être que des théologie ou des religions différentes, et Sapir distinguait la religion – nullement universelle – du sentiment religieux – universel pour lui). Certes, il est contestable de penser que l’accès à un stade supérieur entraîne la disparition de celui antérieur (une époque positiviste peut conserver aussi sa crédulité mystique ou théologique), que l’humanité a toujours eu le même sens selon les cultures et les époques. Mais il y a pourtant un implicite du raisonnement de l’auteur qui est incontestable et qu’il nous faut méditer : les cultures n’existent que conjointement aux conceptions qu’elles inventent (théologique, métaphysique ou scientifique chez l’auteur), et qui ne sont présentes chez aucune espèce animale. Ainsi, ce qu’une société essentiellement théologique considérera comme outil se différenciera du sens donné à ce terme par une culture scientifique, et ne pourra alors avoir les mêmes objectifs que cette dernière. L’outil sera dans le premier inséparable des conceptions magiques et chamaniques (la baguette de sorcier sera considérée comme un outil – ce que remarquait le philosophe Alain qui commentait Auguste Comte qu’il admirait). Dans une société capitaliste l’homme sera un outil à produire de la plus-value, à faire du profit, et sa définition variera alors en fonction des conceptions qui sont faites de tels moyens (de s’enrichir, de s’assurer son autonomie, de prouver la puissance de l’homme a l’égard de la nature – conception de la science moderne dès le 17ème siècle où la conception cartésienne s’oppose à celle de Bacon – et inexistante et conjurée par les sociétés primitives sans états), de même que l’abrogation de l’esclavage implique la fin des visions du monde de l’homme comme outil à exploiter (qui existait chez les Grecs). L’un des derniers représentants survivants des Yahi (indiens de l’Ancienne Californie) surnommé Ishi n’arrivait pas à considérer que la locomotive du peuple Américain qui avait décimé tous les siens, soit un instrument de locomotion : il n’y voyait qu’un démon qui crachait du feu, et considérait comme une démonologie ce que les Américains appelaient technique pour la produire. Il est donc impensable de faire abstraction de telles conceptions pour envisager l’être de l’homme. Il n’y a donc aucune technique et aucun outil sans conception humaine, et aucune raison de comparer alors les instruments (et non les outils!) des espèces animales, incontestables, des conceptions de l’outil au sein des sociétés humaines.
CONCLUSIONS
L’inventaire rapide des exemples répertoriés est certes succinct, mais la logique que nous avons cherché à défendre peut être poursuivie par tout lecteur – parce qu’elle concerne la totalité du réel où l’homme est engagé. Même si les animaux ont des images mentales ou des représentations, l’homme est le seul à nouveau à inventer différentes conceptions de celles-ci (représentations religieuses, économiques, psychologiques, métaphysiques, juridiques, politiques ou psychanalytiques). Concernant le rapport aux rêves il en est de même pour toutes cultures : les rêves sont soit source de perplexité (chez les Yahi de l’Ancienne Californie – sauf le rêve de puissance qui ne se raconte pas), soit encore l’expression de la personnalité profonde qui s’exprime pour toute culture qui pose un inconscient – puisqu’il existe en effet un lien étroit entre l’histoire de l’imaginaire historique (et politique) et les contenus oniriques eux-mêmes ; ainsi, comme l’a montré Jacques Bousquet, à la fin de l’Ancien-Régime les images oniriques ainsi que leurs conceptions, jusqu’alors étroitement reliées aux évocations du paradis et de l’enfer, s’affaiblissent pour progressivement laisser place à d’autres thèmes – les actes involontaires et le dédoublement de la personnalité : et l’onirisme de l’absurde et du bizarre émergent alors (2) . De même pour le rapport à la sexualité : la signification des orgies primitives, des vâmacâri tantriques, des bacchanales grecques, de la prostitution rituelle aux îles Sandwich pendant la décomposition des rois morts – repose sur des conceptions différentes : sacralité de la sexualité, moyen de rencontrer l’intimité d’autrui, de se réaliser intégralement, de décharger des tensions dans une conception hygiéniste, ou recherche du plaisir pour lui-même dans une manière de voir hédoniste. La sexualité est toujours de même genre chez les chimpanzés, preuve de leur absence de conceptions – preuve alors aussi de leur incapacité à construire dans leur nature et leurs relations des directions inédites que traceraient des visions du monde.

Pourquoi s’agit-il alors d’une différence d’orientation entre l’homme et les autres espèces – qui se transforme en différence de nature ? Pour le comprendre, il faut se référer au principe d’exclusion de Marcel Conche qui prouve d’une autre manière notre propre hypothèse, et la renforce. Dans son chapitre IV de L’aléatoire, le philosophe reprend les passages du naturaliste Von Uexküll et de Sombart, pour tenter de distinguer l’homme de l’animal : « Il y a, dit Sombart, une forêt-pour-le forestier, une forêt-pour-le chasseur, une forêt-pour-le-botaniste, une forêt-pour-le-promeneur, une forêt-pour-l’ami-de-la-nature, une forêt-pour-celui-qui-ramasse-du-bois ou celui-qui-cueille-des-baies, une forêt de légende où se perd le petit Poucet », à quoi Von Uexküll ajoute : « La signification de la forêt est centuplée si l’on ne limite pas ses rapports au seul sujet humain, mais si on y fait entrer aussi les animaux ». Marcel Conche critique l’analogie pratiquée ici par le naturaliste, dans la mesure où l’animal, selon lui, ne possède justement pas de perspective : le renard voit la forêt en renard, l’écureuil en écureuil, mais ces derniers n’ont qu’ « un seul point de vue » (est-il dit) sur le monde, les autres et eux-mêmes – contrairement à l’homme qui sait que lui-même, y compris autrui, peut envisager le réel selon une pluralité et une diversité de manières de voir. Dans un autre de ses ouvrages, M. Conche pose un principe d’exclusion pour le démontrer, où il affirme que pour percevoir les choses « d’une certaine façon » il faut pouvoir choisir de ne pas les voir « autrement » : on peut voir le réel selon un point de vue cubiste dans la mesure où l’on ne choisit pas celui impressionniste (ou certains autres) (3) . La conception cubiste est donc compréhensible parce qu’il existe aussi une vision d’un autre genre (fauviste, réaliste ou coloriste par exemple). Ainsi, l’idée qu’un point de vue cubiste existe ne peut l’être que comparativement à d’autres visions du monde. Une manière de voir unique est impossible. Seulement, on peut affirmer avec et contre l’auteur, que si l’animal n’a qu’un seul et unique point de vue sur le réel et non plusieurs, c’est précisément qu’il n’en a aucun, puisque le point de vue en question ne l’est guère en fonction d’un principe d’exclusion préalable (lequel en présuppose d’emblée plusieurs, d’après l’auteur lui-même). On ne peut avoir une unité qu’au sein d’une certaine pluralité : le « un » ne peut être premier, puisque le « premier » implique l’idée d’une suite où sont inclus un « second », un « troisième », etc. L’idée de l’unité ne peut alors être isolée d’une diversité préalable. Or, c’est précisément la raison pour laquelle les animaux sont incapables de construire et de posséder des points de vue. Ils sont capables d’imputer des intentions à autrui, mais incapables de savoir que l’autre pense à sa façon, d’une certaine manière. Le signe de cette situation est visible dans le fait que les conceptions sont chez eux totalement absentes. Les animaux sont liés et reliés à un devenir évolutif, même avec leurs instruments, leur grooming, leurs lavages de pommes de terre dans l’île de Koshima, et sont incapables d’inventer une nouvelle logique (des manières de voir et de penser) pour historiciser leurs capacités, leurs perceptions, leurs sentiments et les manières alors de se référer à ce qui existe déjà pour eux pour en modifier l’orientation (rêves, sexe, outils), et incapables encore d’inventer des conceptions pour créer ce qui n’existe pas (mensonge, familles, méta-représentations…). Raison pour laquelle il ne s’agit pas d’une différence de degré, mais d’un changement radical dans l’orientation par laquelle des êtres construisent leurs pensées, leurs affects, leurs rapports au réel et à leur nature. Cette divergence devient différence de nature puisqu’il existe un critère pour distinguer les êtres humains aussi bien des animaux que de leur nature biologique. En effet, si l’homme procède d’une nature évolutive, celle-ci obéit toujours à la même logique – alors que l’homme désormais invente les siennes par des visions du monde. Et si précisément l’homme invente de telles conceptions, c’est parce que sa nature en est dépourvue.
Notes
- A. Comte, La science sociale, Paris, Éditions Gallimard, 1972, voir notamment le chapitre I « loi de l’évolution intellectuelle de l’humanité ou loi des trois états. ».
- Histoire de la vie privée, 4. De la révolution à la grande guerre (sous la direction de Philippe Ariès et Georges Dubby), Paris, Éditions du Seuil, 1999, p. 438.
- Pour tout ceci, voir M. Conche, l’aléatoire, Paris, PUF, 1999, p. 80, et 212.
Garcia Fabrice, docteur en philosophie.
Après avoir été enseignant-chercheur à l’Université Montpellier III (2000-2003), il a collaboré au CNRS (LIRMM) avec Jean Sallantin (2007), puis enseigné à l’Université du Bas Languedoc (Sète) de 2006 à 2010, ainsi qu’au lycée général durant la même période.
courriel : Philofabricegarcia@yahoo.fr
Site Web : http://taxidermie.00fr.com/
![]() Un autre article de Fabrice Garcia sur Hominides.com : Curiosité animale et humaine
Un autre article de Fabrice Garcia sur Hominides.com : Curiosité animale et humaine
Curiosité humaine et animale Fabrice Garcia
I – Curiosité humaine et animale
II – Hypothèses quant à l’origine de la culture et du langage
III – Derek Bickerton et Conclusion
De l’homme et de l’animal Fabrice Garcia
De l’homme et de l’animal : différences de degré, de nature ou d’orientation ?
Introduction, Mensonge et tromperie – 1ère partie
Le rire et la famille
Fécondité et originalité du concept d’ « Homo demens » Juliette Ihler
Fécondité et originalité du concept d’ « Homo demens »
Le singe descend de l’Homme
Philosophie magazine
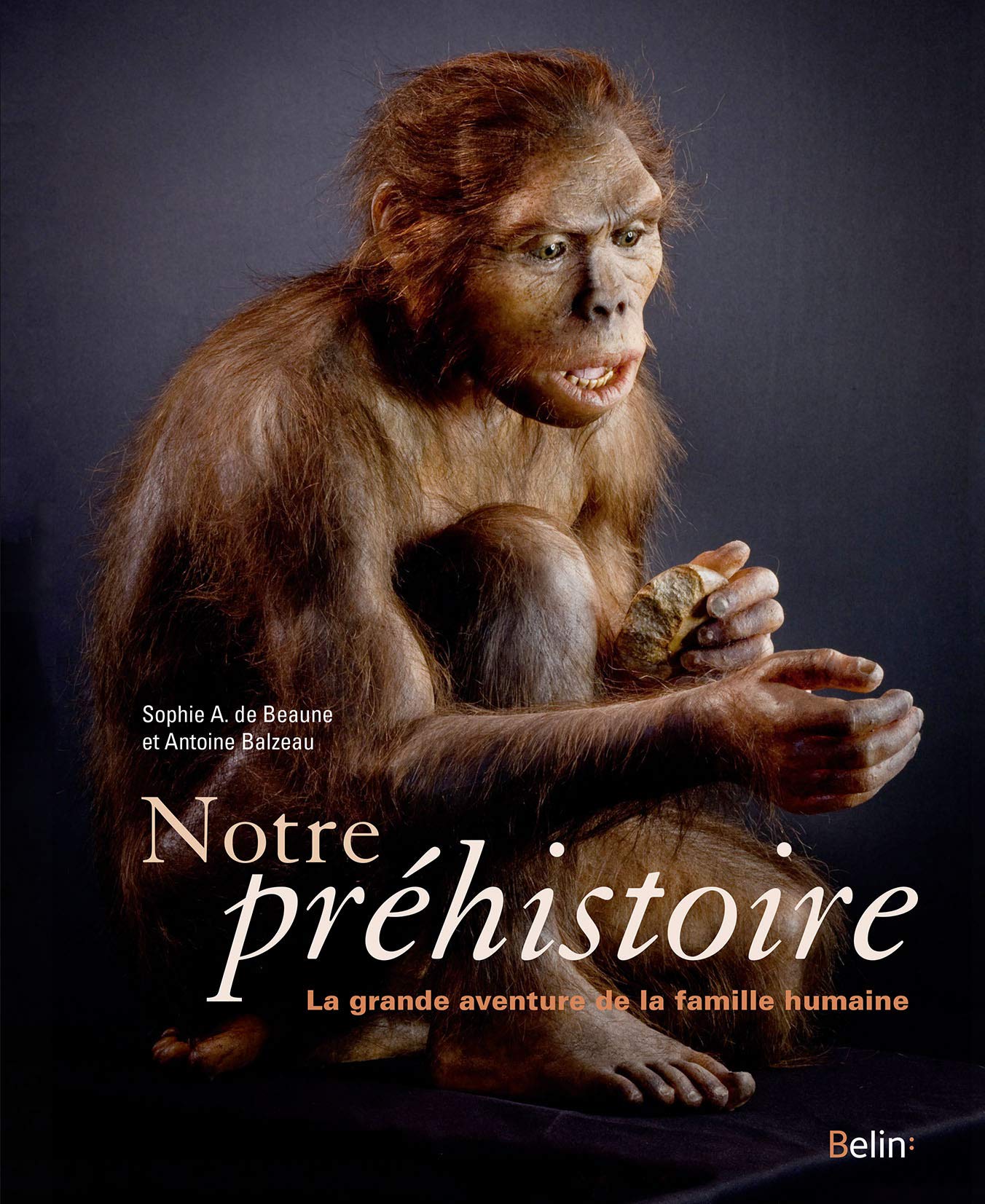

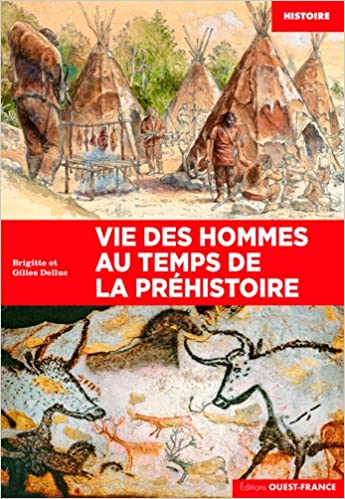

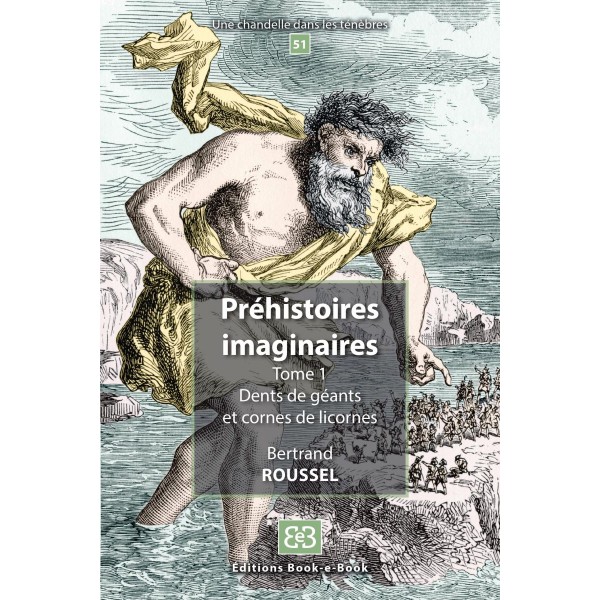
Bertrand Roussel