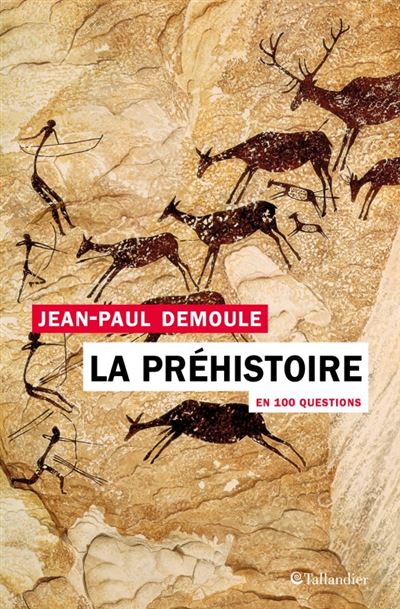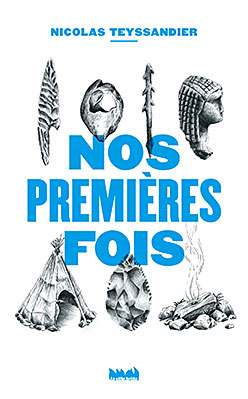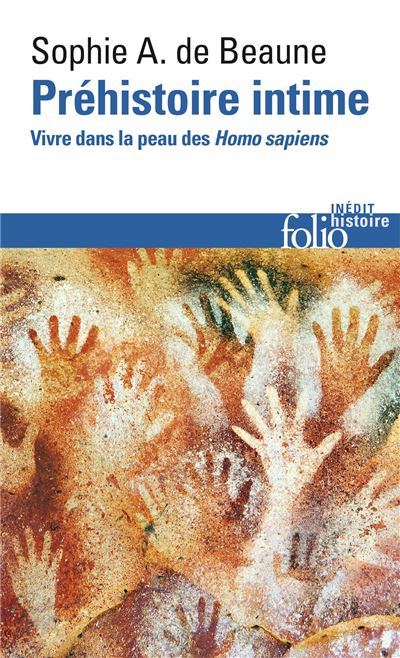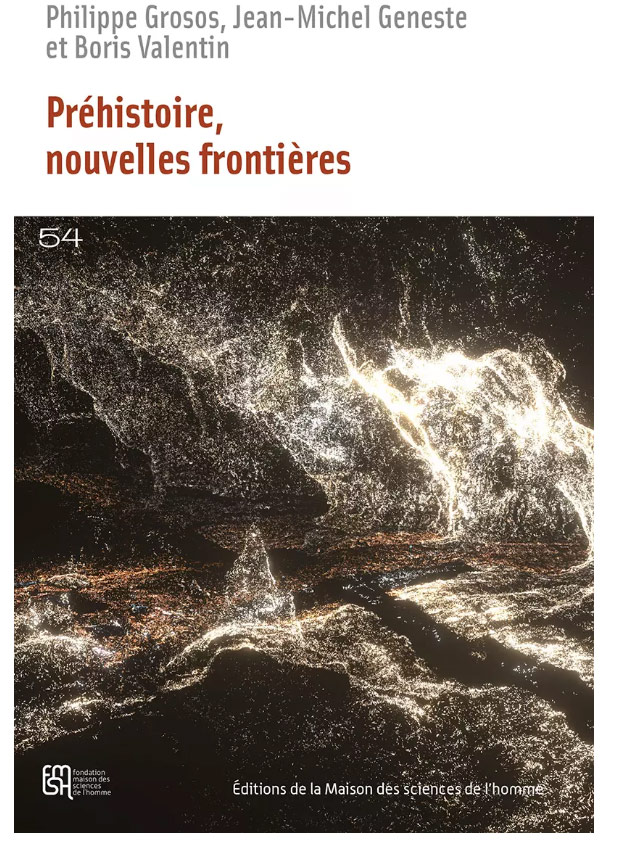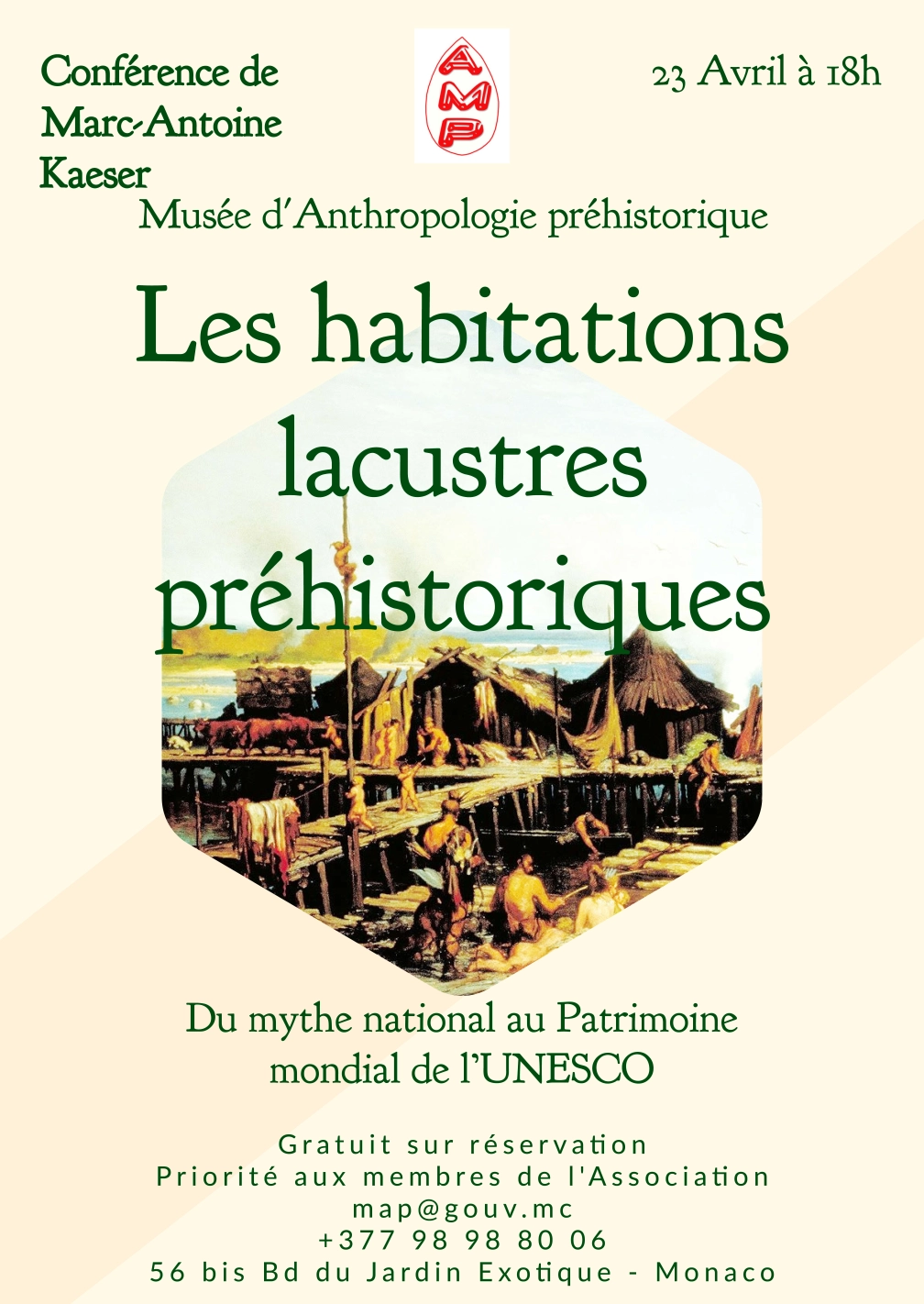Curiosité animale et humaine – 1ere partie
Curiosité animale et humaine – 1ere partie
Fabrice Garcia, docteur en philosophie.
De l’origine des cultures et du langage
Résumé
La culture et le langage se sont développés lorsque la signification interne aux communications par signaux, a fait problème. Il fallait donner du sens à ce qui n’en avait plus naturellement, comme l’atteste la curiosité de certains animaux (les « phénomènes de curiosité » chez les corbeaux, rats, primates), signification qui n’est plus subordonnée à leurs besoins et instincts. Mais si la curiosité animale s’intéresse au sens des objets, la curiosité humaine porte sur la logique. Nous avons là une transition des mammifères supérieurs à l’homme, avec une mutation discontinue. Le langage et les sociétés humaines sont nés pour répondre au problème du sens qu’aucune logique naturelle (biotope, instinct, besoins) ne semble pouvoir fonder, et qui porte sur la logique elle-même, non sur les objets. C’est ce qu’il faut ici démontrer.
I – Curiosité humaine et animale
II – Hypothèses quant à l’origine de la culture et du langage
III – Derek Bickerton et Conclusion
I – Curiosité humaine et animale : liens et différences
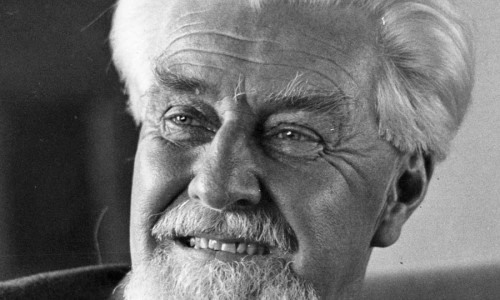
Dans son ouvrage philosophique intitulé L’envers du miroir, l’éthologue Konrad Lorenz, et plus particulièrement dans son chapitre XI consacré au phénomène de curiosité chez l’homme, semble reprendre des réflexions déjà amorcées dans les derniers chapitres de la dernière partie de son ouvrage éthologique, les Trois essais sur le Comportement animal et humain. Lorenz théorise la genèse de l’ouverture de l’homme au monde, à partir de certains éléments logiques présents au sein de la pensée des mammifères. Il remarque qu’il existe des phénomènes de curiosité chez certains animaux. Ces phénomènes de curiosité indiquent que l’animal possède une certaine marge de liberté à l’égard du répertoire comportemental de son espèce. Expliquons cette idée. Un penseur comme René Thom remarque qu’un organisme possède un répertoire limité d’opérations comportementales : le chat peut griffer, mordiller, miauler, etc. Le learning animal consiste, dans une telle optique, à appeler des activités virtuelles qu’un état d’alerte met en branle. Affirmer qu’un organisme est un répertoire de comportements, c’est présupposer le schéma général suivant : on décrit l’être vivant, le chat par exemple, en fonction de ses activités physiologiques (manger, dormir, se reproduire). Ces activités doivent être reliées à des intérêts biologiques, telles que le sommeil ou l’alimentation, et subordonnées à des formes prégnantes (répulsives ou attractives), comme la proie à chasser ou le prédateur à éviter. Pour la faim, la proie ; pour la peur, le prédateur ; pour l’appétit sexuel, le partenaire, etc.(1) Or, les phénomènes de curiosité qu’a su déceler Lorenz semble déroger à ce diagramme comportemental trop réductionniste. En effet, certains animaux sont capables, non plus d’adopter un comportement défini à l’égard d’une situation extérieure définie qui le déclenche, non plus encore d’adopter un comportement fonction d’un besoin intérieur qui le suscite, mais d’avoir plusieurs comportements qui ne sont provoqués par rien d’interne ou d’externe (comme le prouve le jeu ou la curiosité). Ce qui démontre deux choses : d’une part, loin qu’il doive exister des besoins et des instincts qui répondent à des circonstances prédéfinies, il devient possible pour l’animal de choisir des comportements qui ne sont plus contrôlés par le besoin ; d’autre part, que ces actions sont sollicitées pour elles-mêmes. Elles ne sont pas provoquées par un besoin interne ou une circonstance extérieure.
L’auteur le montre en prenant comme exemple le grand corbeau (son exemple fétiche). Exceptés quelques comportements instinctifs de base, rien n’est vraiment prédéterminé au départ chez cette espèce. À partir de son répertoire de comportements préprogrammés, le corbeau essaie de comprendre les objets qui lui sont inconnus, et qui semblent d’autant plus l’intriguer qu’ils sont étrangers aux situations phylogénétiquement spécifiées. L’animal, intrigué par un objet, essaie des comportements agressifs (pour voir si l’objet est dangereux), un comportement nutritif (pour voir si l’objet se mange), essaie de croasser (pour voir si l’objet répond) … C’est dire qu’il n’utilise pas des comportements dans un contexte prédéfini : l’agression n’est pas ici recherchée dans un contexte de lutte entre congénères ou espèces différentes ; le comportement nutritif n’est pas non plus utilisé dans un contexte de recherche de nourriture … Ces comportements sont utilisés dans un contexte de curiosité que le corbeau a suscité. Bref, c’est l’animal qui crée ce contexte, qui n’est en rien sollicité par son besoin, ou par l’extérieur. C’est lui qui recherche activement cette situation. Le corbeau peut porter son attention sur n’importe quel objet, et rechercher ainsi son utilité biologique. Lorenz nous montre que ces phénomènes de curiosité permettent de rejeter les explications fonctionnelles trop réductrices. L’auteur va donc chercher les similitudes qui existent entre les phénomènes de curiosités chez l’animal et chez l’homme, et qui expliquent, selon lui, à la fois la pensée et la culture humaines. En effet, ce dialogue entre l’animal et l’environnement, issu de sa curiosité, serait à la fois un legs de notre condition de mammifère supérieur, et l’assise de notre culture humaine. Cette curiosité, dans la mesure où elle ne répond pas à des situations prédéfinies, comme il en va de l’instinct avec ses objets, serait à la source de la pensée conceptuelle. L’attention pour l’objet comme tel, hors contexte, peut enfin commencer. Lorsque le corbeau tente un comportement d’appétence sur un objet, Lorenz affirme que le corbeau veut savoir au sens théorique du terme, si l’objet en question est consommable. Le dialogue entre le corbeau et les objets de l’environnement, est motivé par une curiosité qui les interroge, et ce, afin d’établir l’amorce de leur conceptualisation : « C’est seulement par l’apprentissage issu de la curiosité que des objets naissent dans le monde environnant de l’animal aussi bien que dans celui de l’homme » (p.220). Autrement dit, parce que l’animal n’est plus subordonné aux objets de son besoin immédiat, il commence à s’ouvrir à un environnement composé d’objets indépendants, loin de le fermer et de le limiter à ses besoins. Cette objectivation permet alors de créer un monde d’objets, et d’apprendre alors les différentes qualités relatives à ces objets, qui est pour Lorenz à l’origine de la culture humaine.
Lorenz fait donc d’une pierre deux coups. La curiosité humaine s’enracine dans une curiosité animale qu’elle développe, et l’origine de la culture humaine dans un fonctionnement cérébral issu des mammifères. L’homme va développer cette curiosité pour l’objet comme tel, en apprenant par le langage à désigner et à nommer les formes et les objets de l’environnement naturel, et ce, grâce aux symboles. Néanmoins, on peut noter une difficulté. Un auteur moins connu, Maurice Pradines, a lui aussi tenté de montrer les similitudes et les différences entre pensée humaine et animale, en s’intéressant au concept de curiosité. Mais si Pradines avait lu Lorenz, il n’aurait pas manqué d’être surpris, non par le concept de curiosité comme tel, mais par la région à laquelle il était réduit. Pradines, mieux que Lorenz selon nous, a distingué les opérations animales et humaines, en commençant par différencier deux types de curiosités : la curiosité pour les signes chez l’animal, et la curiosité pour les raisons chez l’homme : « Et ce qu’on entend par ce mot de pensée […] c’est toujours l’effort pour comprendre la raison des choses qui sont l’objet de l’attention. Par là semblent se différencier tout de suite, en effet, l’intelligence humaine et l’intelligence animale au moins de beaucoup la plus commune. L’animal comprend la signification des choses ; c’est dire qu’un phénomène donné peut lui être un signe, un avis, de ses suites ou de ses concomitants, encore invisibles, habituels ; il ne semble pas chercher, ni pouvoir chercher, à comprendre pour quelle raison les choses arrivent. Car le signe d’une chose n’en est pas une raison, et ce sont deux curiosités différentes que celles des signes et des raisons. »(2) . De manière fascinante, ce passage établit un lien entre curiosité et intelligence. C’est la différence entre deux curiosités qui permet de démontrer leur divergence d’orientation. C’est, tout d’abord, et plus précisément que Lorenz, suggérer qu’il ne s’agit pas d’une curiosité pour des objets, mais pour une logique. Ensuite, suggérer que la curiosité pour cette logique n’implique aucunement que le monde le soit de l’objectivité des objets à fonder, – le concept de raison doit couvrir un champ beaucoup plus plastique et hétérogène que la curiosité pour l’objet ; par exemple, la curiosité à l’égard des raisons qui font que l’objet est là « pourquoi cela est ici, pourquoi ces choses sont-elles réunies ensemble, pourquoi cela n’est pas ici, pourquoi ne puis-je pas faire cela? », etc. C’est lorsque j’ai répondu au problème que ces questions me posent, que commence à exister un monde. Ce qui veut dire alors qu’il existe une différence de nature entre la curiosité animale et celle humaine, et que la culture, ni ne continue, ni ne développe notre curiosité face aux objets situés autour de nous. En effet, alors que l’animal s’ouvre à l’environnement extérieur en s’intéressant, par sa curiosité, aux objets de cet environnement, l’homme, par la recherche des raisons qui le définit, découvre un monde qui n’a plus en lui-même sa raison d’être. C’est dire qu’il ne s’ouvre pas aux formes extérieures, ni qu’il va essentiellement chercher à les désigner. Il va chercher à répondre au problème qu’une logique commence à lui poser. Il cherche la signification d’une logique qui fait pour lui problème, non à répondre au sens des objets. Enfin, il existe un hiatus entre les opérations de pensée animale et humaine, contrairement à ce que Lorenz laisse entendre, lorsqu’il parle des prémisses de l’objectivation chez l’animal, en suggérant une forme de continuité entre elles. La compréhension pour les raisons contraste avec l’intellection qui porte sur des signes. Il s’agit d’une différence de nature et non de degré. Et cette différence se fait différence d’orientation à l’égard de l’environnement. Et c’est ainsi que Pradines distingue la cognition animale de la cognition humaine.
(1) cf. René Thom, Stabilité structurelle et morphogenèse, Paris, InterEditions, 1977, notamment l’appendice 2 intitulé « catégories grammaticales, typologie des langues et écriture », pp. 331-334.
(2) Maurice Pradines, traité de psychologie générale, Le génie humain, ses œuvres (Technique, religion, art et science, langage, politique),Paris, PUF, 1946, pp. 21-22.
I – Curiosité humaine et animale
II – Hypothèses quant à l’origine de la culture et du langage
III – Derek Bickerton et Conclusion
Garcia Fabrice, docteur en philosophie.
Ayant appartenu à l’équipe de recherche de Montpellier III et enseigné de 2000 à 2003 à Paul Valéry.
Appartenant actuellement à l’UTL de Sète (Université Temps Libre)
courriel : philofabricegarcia@yahoo.fr
Un autre article de Fabrice Garcia sur Hominides.com : De l’homme et de l’animal : différences de degré, de nature ou d’orientation
Bibliographie conseillée
L’envers du miroir
Konrad Lorenz
Paris, Flammarion, 1975
Achat sur Amazon
Traité de psychologie générale, II le génie humain, ses oeuvres
Maurices Pradines
Achat sur Amazon
L’aventure de l’esprit dans les espèces
Maurices Pradines
Paris, Flammarion, 1954
Achat sur Amazon
L’animal l’homme la fonction symbolique
Raymond Ruyer
Paris, Flammarion, 1964
Achat sur Amazon
L’homme et l’animal, essai de psychologie comparée
F.J.J. Buytendijck
Paris, Gallimard, 1965
Achat sur Amazon
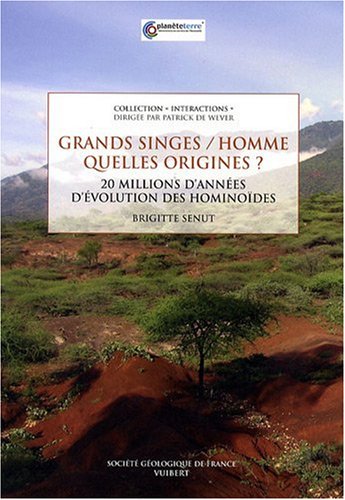


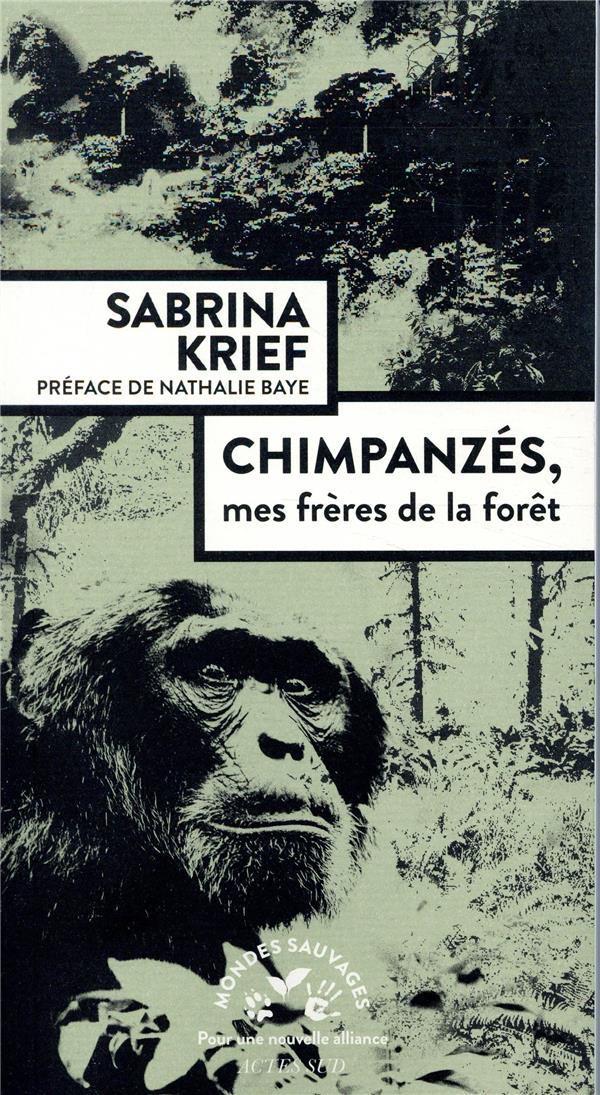
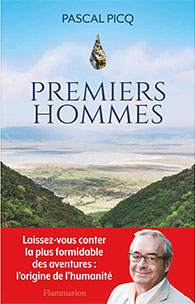

Brigitte Senut avec Michel Devillers
Curiosité humaine et animale Fabrice Garcia
I – Curiosité humaine et animale
II – Hypothèses quant à l’origine de la culture et du langage
III – Derek Bickerton et Conclusion
De l’homme et de l’animal Fabrice Garcia
De l’homme et de l’animal : différences de degré, de nature ou d’orientation ?
Introduction, Mensonge et tromperie – 1ère partie
Le rire et la famille
Fécondité et originalité du concept d’ « Homo demens » Juliette Ihler
Fécondité et originalité du concept d’ « Homo demens »
Le singe descend de l’Homme
Philosophie magazine
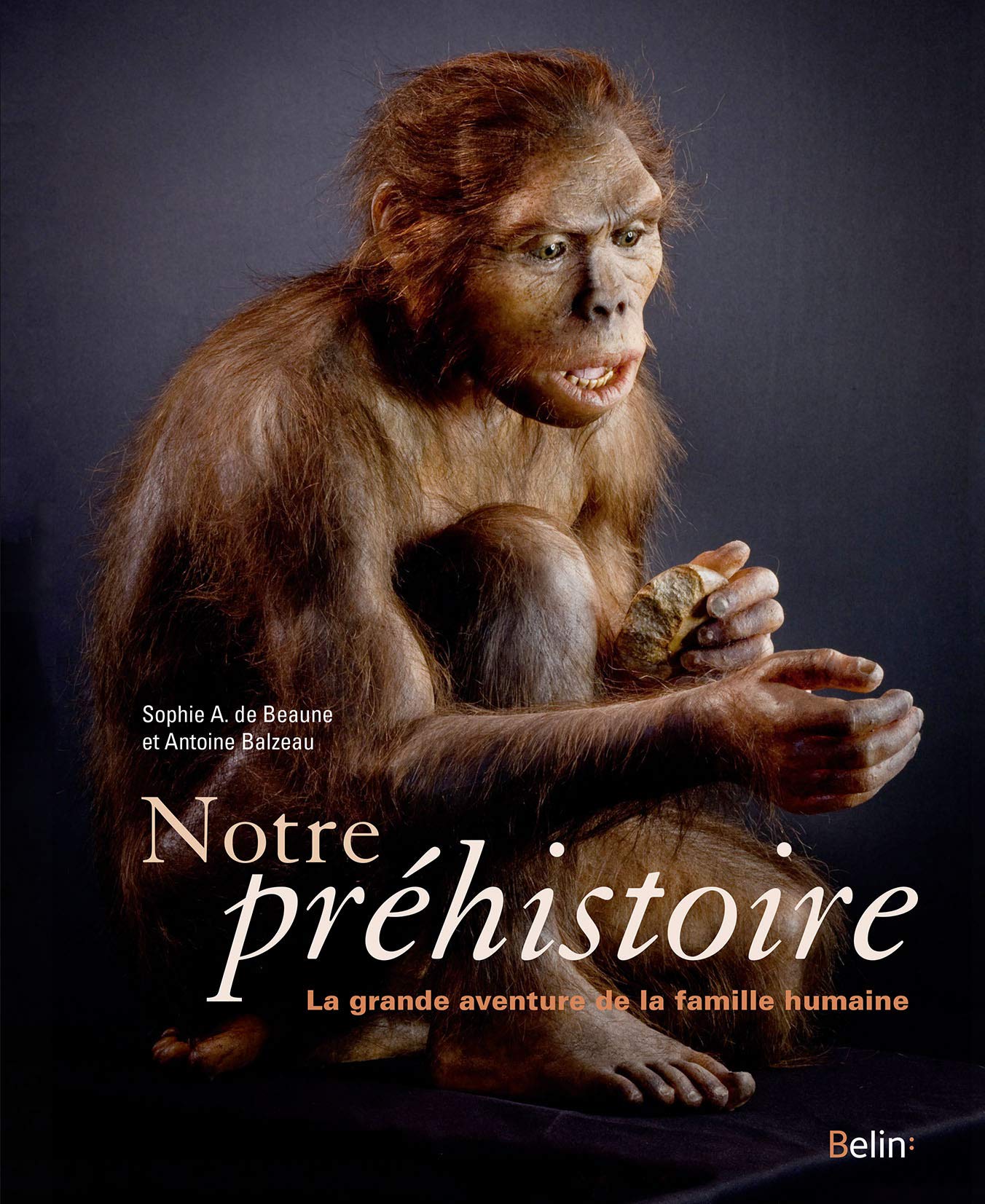

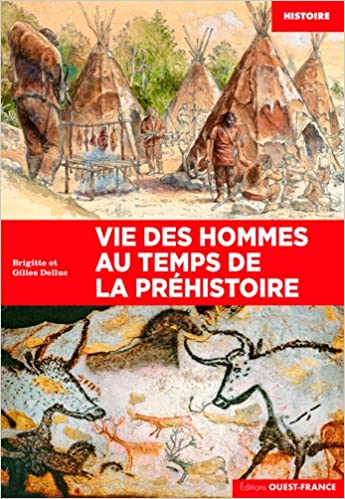

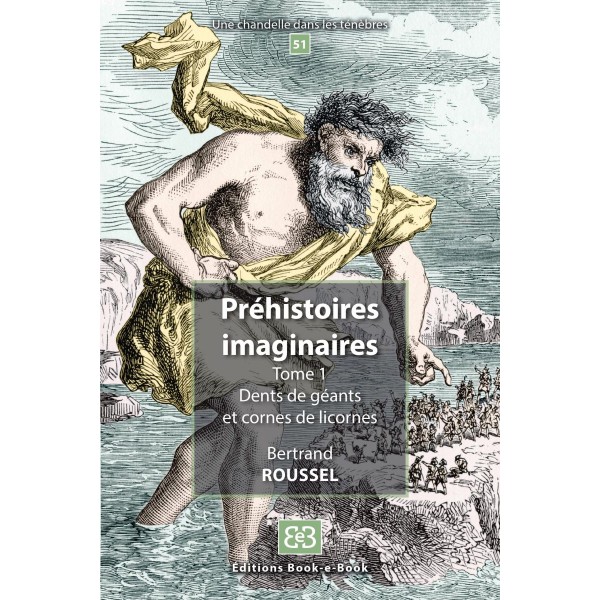
Bertrand Roussel