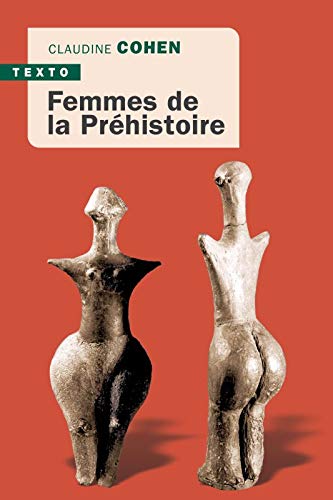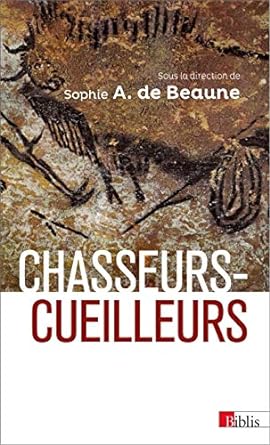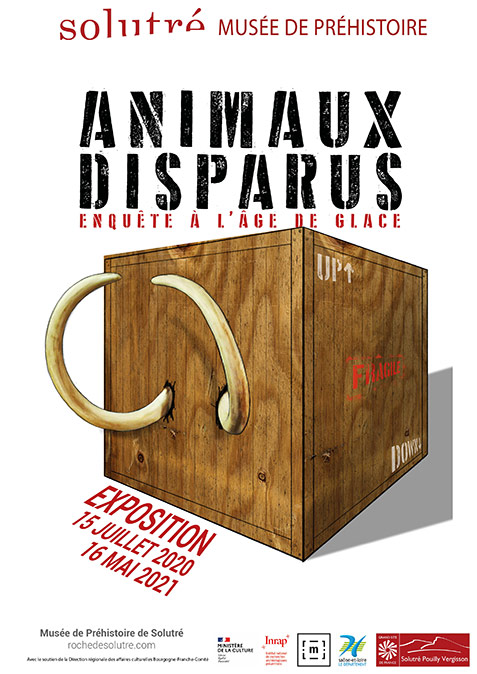De l’homme et de l’animal… Le rire et la famille – 2ème partie
De l’homme et de l’animal : différences de degré, de nature ou d’orientation ?
Fabrice Garcia, Docteur en philosophie.
Le rire et la famille
Résumé
Si la frontière entre l’homme et les autres espèces semble de plus en plus incertaine aujourd’hui, en raison de nombreuses découvertes éthologiques et même primatologiques, force est d’entreprendre la relecture des faits proposés par ses disciplines, afin d’éclaircir la différence qui existe pourtant entre l’être humain et les animaux – et ce, grâce à une nouvelle hypothèse : l’espèce humaine en effet est la seule à élaborer des conceptions et des visions du monde. Sa différence avec les autres vivants (et leur rapport à la vie) est d’orientation et non de degré. Il s’agit alors de découvrir les signes qui prouvent l’existence de telles facultés en l’homme, et d’expliquer cette hypothèse de la différence d’orientation.
De l’homme et de l’animal : différences de degré, de nature ou d’orientation
I – Mensonge – Tromperie tactique
II – Le rire – La Famille
III – Les outils – Conclusion
LE RIRE
Dans son fameux « avis aux lecteurs », Rabelais reprenait l’adage d’Aristote pour qui le rire est le propre de
l’homme (1) . Cette capacité semble pourtant, aux yeux de plusieurs éthologues contemporains, présente chez plusieurs espèces vivantes. Ainsi, Elke Zimmerman (zoologue de Hanovre) découvre une étonnante parenté entre le rire des bonobos et ceux des jeunes enfants. De même encore, les travaux de Jaak Pankseep semblent confirmer la présence d’une telle capacité chez les rats – dans leur jeu, en effet, ou lorsque les examinateurs les manipulent d’une certaine façon, un gazouillis ultrasonique d’une fréquence de 50 kHz se distingue de la fréquence des sons associés à un échec social ou événement négatif (22 kHz) – signe apparent d’une joie qui s’exprime (2) . Mais pourtant, à supposer légitime une telle hypothèse, force est à nouveau de constater qu’aucune espèce ne possède des conceptions et des points de vue différents sur le rire. Supposons que chez l’homme une telle capacité soit innée sous prétexte que ses circuits neuronaux se trouvent présents dans des zones cérébrales phylo-génétiquement anciennes : son rire est pourtant encadré par des conceptions différentes : cynisme, humour noir, comique, ironie, absurde, bouffonnerie… ; de même encore, il en invente dans chaque registre des usages différents grâce au langage : comique de mots, de situations, de jeux de mots, de répétition, d’exagération. De même enfin, les valeurs et conceptions du rire seront en étroite dépendance avec les définitions qui leur sont attribuées. Le rire peut être envisagé comme un « élément contribuant à la santé et au moral » (qui implique une certaine conception du rapport entre une vision du comique et de la santé), une nouvelle arme de séduction auprès de la gente féminine (qui suppose une autre conception du lien entre une manière de percevoir le rire et l’attraction sexuelle), un moyen encore de mettre à distance le sérieux du monde pour le conjurer (mise en relation avec le principe de réalité). Il est d’ailleurs remarquable de voir la biologie rechercher l’origine du rire à partir d’une certaine conception au lieu de réfléchir sur les manières grâce auxquelles les hommes en élaborent leurs propres visions (ainsi est-il conçu comme signal de sécurité chez Spencer – apaisement après un danger ; arme d’intimidation de l’adversaire chez Hayworth ou moyen de renforcer la cohésion du groupe si l’ennemi est extérieur comme chez Eibelfest). Prenons à titre d’exemple la différence de conceptions entre l’ironie chez Comte-Sponville et Anatole France (3) . Chez le premier, l’ironie est considérée comme une manière de se positionner hiérarchiquement au-dessus des autres afin de les dévaloriser et de se re-valoriser (ou sur-valoriser). Le sentiment qui s’y exprime est donc lié à la haine ou le ressentiment – que l’auteur considère à juste titre comme un vice. Au contraire, chez Anatole France, l’ironie est une méthode grâce à laquelle on cherche à redescendre autrui de l’image sur-valorisée qu’il se donne pour le rappeler à sa modestie (nous ne nous plaçons donc pas au-dessus des autres qu’on dévalorise en les plaçant au-dessous de nous : il s’agit de redescendre autrui de l’image trop haute qu’il se donne), l’ironie devenant une arme qui permet de s’éloigner affectivement de l’autre et sans laquelle l’homme développerait sa haine. Ces capacités sont le signe de conceptions sous-jacentes auxquelles aucune espèce n’a accès. Il n’y a donc aucun point commun entre le rire chez l’être humain (puisque de telles conceptions dépendent des visions du monde) et les animaux pour qui le rire se manifeste sans aucune conception (d’où son étrangeté!) – dans les mêmes situations, les mêmes contextes, avec toujours le même et unique sens.
LA FAMILLE
Dans une conférence, Dominique Lestel défend l’hypothèse de familles animales. L’auteur semble pourtant méconnaître le sens d’une telle notion qui, elle-aussi, repose sur des conceptions qui en justifient l’acception et commet la même erreur que Locke dans son Essai sur l’entendement humain (et de même encore dans son autre ouvrage consacré à l’amitié aussi bien entre animaux qu’entre homme et animal, il oublie qu’il existe plusieurs conceptions de cette dernière : celle des grecs à l’époque d’Aristote n’a rien à voir avec celle des années 50 en Italie pour qui l’ami était celui qui aidait à réussir socialement – D. Lestel inventant sans le voir une nouvelle vision de l’amitié – ce qui conforte notre hypothèse !). Dans le §2 du chapitre 28 du livre II de son Essai sur l’entendement humain, J. Locke met à jour ce qu’il nomme les relations naturelles. Il écrit à ce sujet : « ce sont les circonstances de leur origine ou de leur commencement, qui n’étant pas altérées dans la suite, fondent des relations qui durent aussi longtemps que les sujets auxquels elles appartiennent, par exemple père et enfant, frères, cousins germains, etc. dont les relations sont établies sur la communauté d’un même sang auquel ils participent en différents degrés ; compatriotes, c’est-à-dire, ceux qui sont nés dans un même pays. Et ces relations, je les nomme naturelles. Nous pouvons observer à ce propos que les hommes ont adapté leurs notions et leur langage à l’usage de la vie commune, et non pas à la vérité et à l’étendue des choses. Car il est certain que dans le fond la relation entre celui qui produit et celui qui est produit est la même dans les différentes races des autres animaux que parmi les hommes : cependant, on ne s’avise guère de dire, ce taureau est le grand-père d’un tel veau, ou que deux pigeons sont cousins germains. Il est fort nécessaire que parmi les hommes on remarque ces relations et qu’on les désigne par des noms distincts […] Mais il n’en est pas de même des bêtes. Comme les hommes n’ont que peu ou point du tout de sujet de leur appliquer ces relations, ils n’ont pas jugé à propos de leur donner des noms distincts et particuliers ». Plusieurs remarques :
- L’auteur montre ici que l’homme est capable de se représenter la coexistence de plusieurs termes au sein d’un ensemble, qu’ils sont en relation les uns les autres à partir de l’idée maîtresse de filiation. Les exemples qu’il examine sont reliés grâce à la notion de commencement, de genèse et d’aboutissement : le père est à l’origine du fils, le fils est l’aboutissement du père, et le père est aussi fils de… dans la mesure où il est généré par un autre terme – le père, lointaine origine du petit fils dont il est le grand-père, etc. Dans cette partie, l’auteur montre que les individus partagent un ensemble de représentations collectives où ils peuvent se situer les uns à l’égard des autres : ces réalités restent constantes dans le temps malgré les variations sensibles et physiques des individus. Il est intéressant de constater que l’auteur ne se pose pas la question de savoir si cette aptitude à se percevoir en fonction d’un dénominateur commun, lequel nous permet de nous représenter comme issu ou affilié à autrui par une généalogie, n’est pas un critère à partir duquel distinguer l’homme de l’animal. En effet, c’est pourtant très précisément à partir d’une telle faculté que Lévi-Strauss va pouvoir établir une ligne de démarcation entre l’humain et l’animalité, lorsqu’il théorise les structures élémentaires de la parenté dans son ouvrage du même nom. D’après cet auteur, les règles qui définissent la sphère sociale reposent sur la parenté qui permet de comprendre la fonction des systèmes matrimoniaux élémentaires, laquelle explique que les individus sont représentés comme des “biens” afin de circuler socialement, pour créer et consolider en retour un rapport entre membres de la communauté. Dans le langage de l’anthropologue, sont élémentaires les structures de parenté qui déterminent des conjoints prohibés ou prescrits pour permettre des échanges entre familles (conjoints préférés ou possibles) ; sont complexes au contraire les systèmes qui ne prescrivent plus un conjoint particulier, lequel se trouve alors choisi selon des critères personnels et non plus familiaux (lesquels pourront inclure des paramètres aussi divers que la richesse, la beauté, ou la renommée, etc.). Une telle structuration sociale suppose, on le voit, des opérations de pensée qui ressemblent à celles que J. Locke a mises à jour, et dont il ne convient pas ici de savoir si elles sont d’origine psychologique ou sociologique. Toujours est-il qu’une telle aptitude permet d’organiser des représentations non pas annexes et accessoires, mais constitutives de toute une logique de l’organisation et de rapports sociaux qui semblent réaliser le genre humain.
- L’auteur montre bien que l’animal ne semble pas avoir de telles représentations, à tel point que cette impossibilité semble indirectement vérifiée par le fait que l’homme n’applique pas ses catégories sur les espèces qu’il observe dans la nature, ou sur celles qu’il a domestiquées. Si l’homme n’hésite pas à parler du rapport entre la mère et les petits lorsqu’il est question de la relation directe entre la femelle et sa progéniture, il semble pourtant beaucoup plus réservé sur les relations indirectes entre les différents membres du groupe, de même qu’il est sceptique lorsqu’il s’agit d’ attribuer à l’animal la capacité de se penser en fonction d’une filiation autre que celle directement perceptible. S’il semble à première vue raisonnable de penser qu’un petit voit sa “mère”, il semble difficile d’imaginer en retour qu’il se comprend comme son fils, ou que le père de sa mère est son grand-père, voire le père de sa mère. On pourrait penser que la différence entre l’homme et l’animal n’est relative qu’à l’extension que la pensée peut embrasser à ce sujet, ce qui supposerait la présence conjointe alors d’une même capacité. J. Locke affirme en effet qu’il s’agit d’une même communauté, reposant sur un même principe : l’affiliation sanguine. L’homme serait alors capable de découvrir sa généalogie, et l’animal tout juste capable de circonscrire sa relation aux liens directs (quoi que cette dernière dénomination soit problématique : le chimpanzé mâle saisit-il directement la femelle comme sa compagne, ou comme la mère des petits dont il est le géniteur et le père ?). Mais c’est là une erreur historique et sociologique des plus graves quant à la conception de la famille à laquelle il se réfère. En effet, l’être humain ne découvre pas l’ensemble trans-historique et universel auquel il est naturellement affilié ; il s’agit bien au contraire d’une création des visions du monde des plus relatives – et qui dépend de conceptions. A. Cuvillier l’avait rappelé : la famille se compose en effet de deux groupes sociaux, formés par la société conjugale (le groupe des époux) et la société des domestiques (le groupe des parents). Si dans certaines cultures, dont la nôtre, les deux groupes n’en forment plus qu’un, c’est parce qu’elles ont privilégié l’axe de la consanguinité. Or, il existe et a existé nombre de sociétés dont le lien de référence est tout idéal. Il n’est pas rare de découvrir une époque ou une culture se référer à un ancêtre commun des plus mythiques, auquel un culte public a été voué. Ainsi, à Rome, la parenté a d’abord été une notion essentiellement religieuse, où la “famille particulière” appartenait à une “plus vaste famille” – laquelle comprenait tous ceux qui participaient au culte de mêmes ancêtres. Le mariage ne constituait pas le fondement du groupe familial, puisque celui-ci reposait essentiellement sur la perpétuité du culte domestique. Cette grande famille reposait sur plusieurs attributions différentes qui la définissaient : religieuses, juridiques et économiques, aujourd’hui disparues dans nos sociétés.
De même, chez les Inuits, le système de dénomination permet un transfert d’identité personnelle d’une génération à l’autre, ce dernier étant réalisé par plusieurs termes semi-indexicaux de parenté (“maman”, “mon fils”). De même encore, chez certains peuples mélanésiens de Nouvelle-Calédonie, il existe un système de dénomination dans lequel c’est l’identification aux couples parentaux et aux relations totémiques qui prédominent. Lewis H. Morgan remarque que les enfants des Iroquois appellent “père” non seulement leur géniteur biologique, mais aussi le frère de ce dernier, de même que ce dernier l’appelle à son tour “mon fils”. Enfin, pour reprendre un exemple de Lévi-Strauss à l’égard des sociétés primitives, les cousins parallèles sont appelés “frères et sœurs” et considèrent leur mariage comme incestueux, tandis que les cousins croisés se voient nommés “époux et épouses”. Ce qui signifie, d’une part, que la parenté, bien avant d’être physiologique, a d’abord été une notion morale qui implique plusieurs croyances (économiques, juridiques et religieuses) ainsi que plusieurs jugements de valeurs, et donc plusieurs visions du monde ; et, d’autre part, “que la famille humaine diffère essentiellement, et non pas seulement en degré, de la famille animale”, vu que l’idée de consanguinité familiale n’est que le résultat tardif d’un long et lent processus historique (4) .

Il y a plusieurs manières de le démontrer : tout d’abord, il n’y a aucune conception de la famille sans l’invention de différentes manières d’envisager les rapports entre échange et alliance. Ainsi, chez les Na de Chine le mariage n’existe pas (pas plus que les mots « père » et « mari » !) et les familles se forment par des échanges sans alliance. Au contraire, les Égyptiens se sont construits selon des alliances sans échange (puisque se mariant entre frères et sœurs), et la plupart des autres cultures forment des alliances par échange – avec à chaque fois des points de vue différents sur les raisons les justifiant (5) . Selon les cultures, les termes « père », « mari » et « géniteurs » ne sont aucunement synonymes. Ainsi, dans les sociétés matrilinéaires où la femme est considérée comme portant déjà virtuellement en elle l’enfant déjà formé, mais ayant besoin d’une nourriture pour croître (le sperme du mâle), l’homme est considéré comme celui qui permet à l’enfant de se développer : il n’est aucunement conçu comme celui contribuant à créer l’enfant avec la femme (comme dans le christianisme par exemple). Il est donc un père (Trobriand) mais pas un géniteur (alors que dans la conception chrétienne le géniteur est père). Ces termes n’ont donc aucun sens naturel et ne sont possibles qu’au sein de choix parmi plusieurs visions du monde que des cultures acceptent en rejetant alors simultanément certaines autres. Raison aussi pour laquelle le primatologue et philosophe D. Premack critique la catégorie de « mère » que l’éthologue Verena Dasser a cru découvrir chez les chimpanzés (à partir d’une expérience contestable) (6) . Ensuite, l’observation des sociétés animales (bonobos, gibbons, chimpanzés, macaques) nous prouve que chez l’être humain les hommes et femmes s’associent pour éduquer leur enfant qui le restera même après avoir quitté sa famille (au contraire, chez les espèces répertoriées précédemment, le père ne fait que jouer avec le petit ou le protéger quand il est dans son périmètre visuel, sachant qu’une fois la puberté atteinte les jeunes mâles et femelles quitteront définitivement leur groupe sans jamais y revenir, et même les frères avec qui ils ont pourtant joué).
Notes
- Aristote, Des parties des Animaux, III, X.
- Voir Yves Christen, L’animal est-il une personne ? Paris, Flammarion, 2009, p. 89.
- Comte-Sponville, Petit traité des grandes vertus, paris, PUF, 1995, pp. 315-318. Anatole France, le jardin d’Épicure, Paris, Calman-Lévy, 1895, pp. 121-122.
- A. Cuvillier, Cours de philosophie, tome 2, Paris, Armand Colin, 1954, p. 330-331.
- M. Godelier, Métamorphose de la parenté, Paris, Flammarion, 2010, chapitre X.
- D. & Ann Premack, Le bébé, le singe et l’homme, Paris, Odile Jacob, 2003, p. 257.
Garcia Fabrice, docteur en philosophie.
Après avoir été enseignant-chercheur à l’Université Montpellier III (2000-2003), il a collaboré au CNRS (LIRMM) avec Jean Sallantin (2007), puis enseigné à l’Université du Bas Languedoc (Sète) de 2006 à 2010, ainsi qu’au lycée général durant la même période.
courriel : Philofabricegarcia@yahoo.fr
Site Web : http://taxidermie.00fr.com/
![]() Un autre article de Fabrice Garcia sur Hominides.com : Curiosité animale et humaine.
Un autre article de Fabrice Garcia sur Hominides.com : Curiosité animale et humaine.
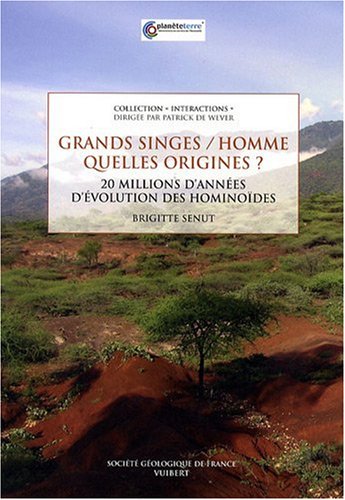


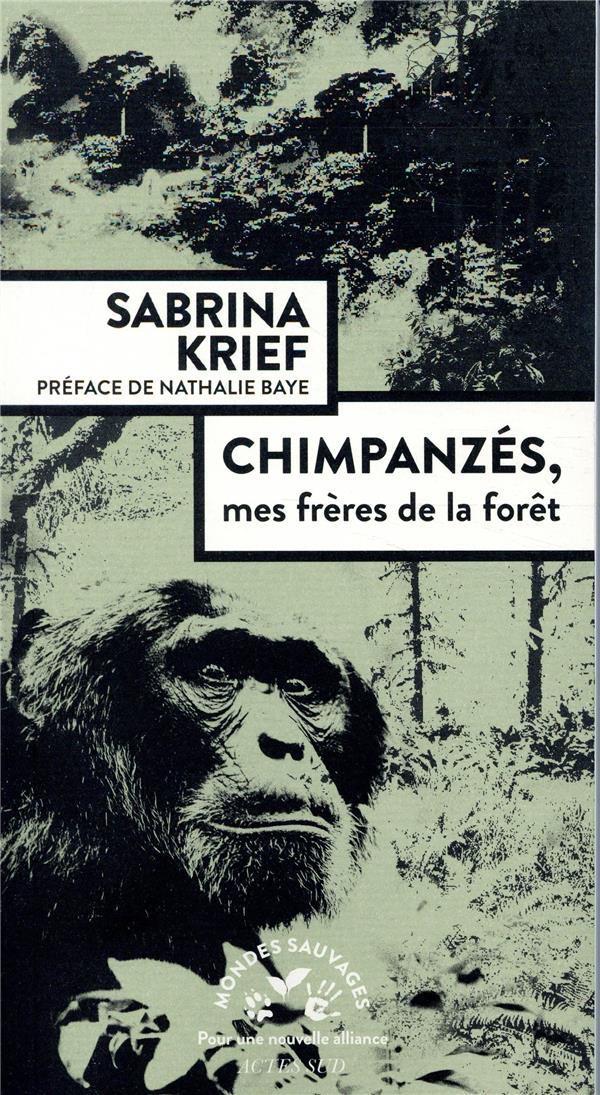
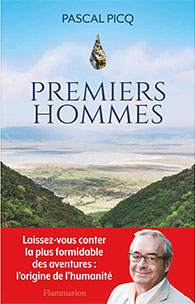

Brigitte Senut avec Michel Devillers
Curiosité humaine et animale Fabrice Garcia
I – Curiosité humaine et animale
II – Hypothèses quant à l’origine de la culture et du langage
III – Derek Bickerton et Conclusion
De l’homme et de l’animal Fabrice Garcia
De l’homme et de l’animal : différences de degré, de nature ou d’orientation ?
Introduction, Mensonge et tromperie – 1ère partie
Le rire et la famille
Fécondité et originalité du concept d’ « Homo demens » Juliette Ihler
Fécondité et originalité du concept d’ « Homo demens »
Le singe descend de l’Homme
Philosophie magazine
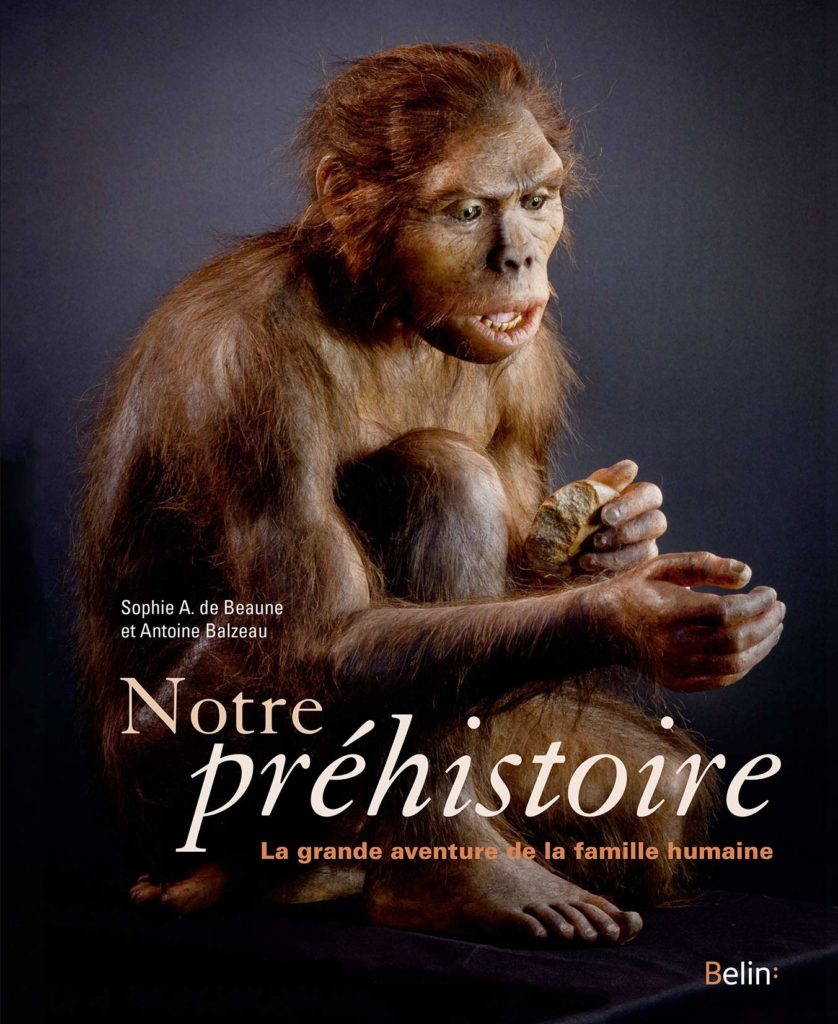
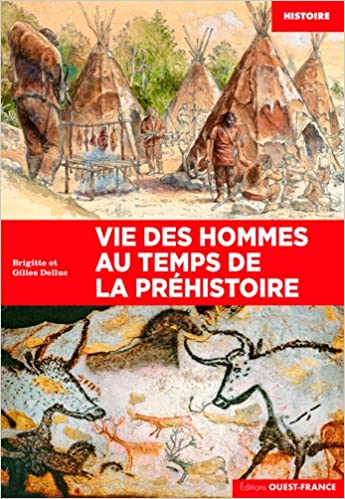
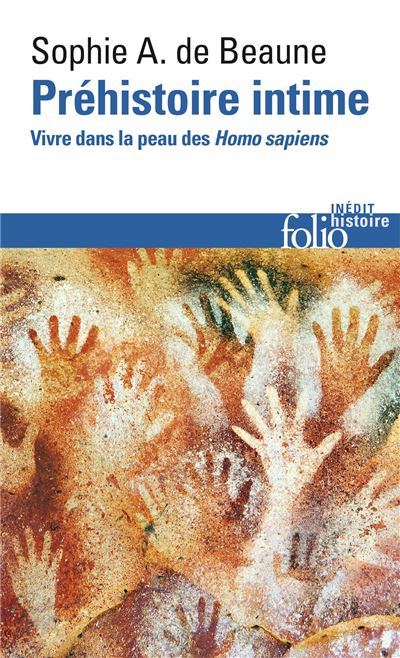
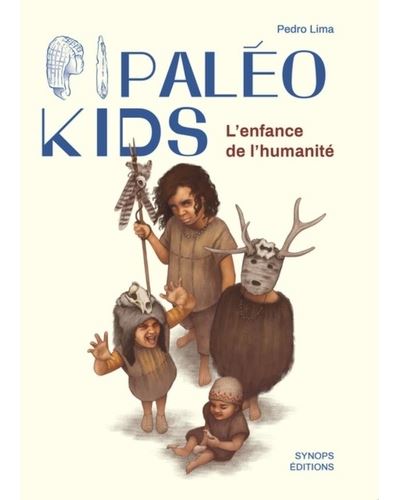
L’enfance de l’humanité
Pedro Lima